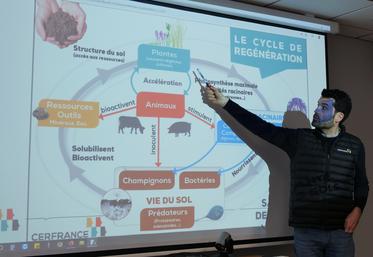Interview
Ce n’est pas parce qu’une crise est permanente que ce n’est plus une crise
Olivier de Schutter, rapporteur spécial près
les Nations unies sur le droit à l’alimentation.

Le monde a connu les émeutes de la faim en 2008. Cette leçon est-elle retenue alors qu’on prévoit 9 milliards d’habitants sur terre en 2050 ?
Olivier de Schutter : la crise alimentaire de 2008 a suscité un électrochoc et la question du soutien à la production agricole est de nouveau au sommet de l’agenda politique. C’est encourageant. Beaucoup de gouvernements des pays du sud, qui avaient largement négligé leur agriculture pendant trente ans, hormis quelques filières export, se rendent compte de leur erreur et cherchent une porte de sortie. Toutefois il reste à définir les orientations car il y a un risque de répondre à la demande de production, sans répondre au problème du revenu des paysans.
L’enjeu est de savoir quelle agriculture il faut pour demain. Est-ce une concentration de plus en plus forte entre les mains des plus puissants ou une production plus décentralisée, avec un ciblage sur l’agriculture familiale. Dans ce cas, ce sont des politiques ciblées qu’il faut mettre en action.
Il n’y aurait donc pas de place pour les deux types d’agriculture ?
Je ne dis pas cela. Car si les deux types d’agriculture ne peuvent coexister, on est mal parti. Prenons le cas du Brésil : à côté des grandes exploitations destinées à l’export, il y a des petites exploitations pour le marché intérieur. Ces deux agricultures reçoivent des soutiens, mais ont un ministère différent. Certains, comme Via Campesina, estiment que la coexistence n’est pas possible. J’espère qu’ils ont tort, car il serait alors très difficile de défendre l’agriculture familiale.
Un rapport de la FAO, repris dans Le Monde (au 15/09/10) indique que la faim est en « léger recul » en 2008. Les bonnes intentions ne risquent-elles pas d’être revues ?
Ces chiffres ne tiennent pas compte des augmentations de cet été sur le blé, le maïs, le riz. Et quand même, 925 millions de gens souffrant de la faim, quel échec. Donc, nous sommes toujours en crise. Et ce n’est pas parce qu’une crise est permanente qu’elle n’est plus une crise. Et qu’il ne faille pas trouver des solutions.
L’agriculture familiale, telle que vous l’évoquez, est-elle de taille à répondre aux enjeux de la faim dans le monde ?
L’agriculture familiale, victime de préjugés, n’a jamais été considérée comme viable et n’a connu que peu d’investissements. Cette attitude a débouché sur une sorte de prophétie autorisatrice : on n’a pas investi, donc elle n’a pas été assez productive. Or, il faut se méfier de la manière dont le marché attribue ses récompenses, car l’agriculture familiale garantit des fonctions : développement rural, emploi, respect des écosystèmes, etc. - ce qu’on désigne par le terme de multifonctionnalité - que les grandes plantations fortement mécanisées, ne remplissent pas. Et que le prix des aliments payé par le consommateur ne prend pas en compte. La compétitivité de l’agro-industrie ne doit donc pas être le seul critère d’orientation des politiques publiques.
Que peut le droit à l’alimentation en la matière ?
Le droit à l’alimentation est un outil pour analyser la question de la faim. Ce droit signifie que les politiques mises en œuvre ne doivent pas être guidées uniquement par le soutien à l’offre pour répondre à une demande croissante mais qu’il faut le faire en ciblant les efforts et en intégrant la notion de revenus aux producteurs.
Cela vaut pour les agriculteurs du nord ?
Absolument, car ce droit est aussi pertinent pour tout ce qui touche les rapports de force dans les filières. Il peut être un outil pour les gouvernements afin d’examiner la répartition des marges par exemple. Le droit à l’alimentation s’intéresse également au renforcement des chaînes courtes, les marchés fermiers, etc. Ce sont autant de sujets communs aux agriculteurs du nord et du sud.
Et la spéculation ?
La spéculation est un vrai problème qui s’est accentué depuis dix ans, avec la libération du marché des produits dérivés. La visibilité devient ératique. Face à cela, les États-Unis ont décidé de limiter le nombre de positions détenues par ces investisseurs. Dans l’Union européenne, on penche plutôt vers un renforcement de la transparence de ces marchés dérivés en limitant les possibilités des contrats de gré à gré qui représentent 92 % des transactions. Est prévu également un contrôle par la puissance publique. Cela me semble un peu moins ambitieux.
Propos recueillis
par Martine Leroy-Rambaud